
De Gabrielle Roy à France Daigle, les auteurs franco-canadiens issus de milieux minoritaires marquent la littérature d'ici. Survol de leur émergence et suggestions de lectures.
Par Pascale Guéricolas
Certaines littératures exhalent un parfum de réalisme magique, comme les œuvres des auteurs sud-américains. D’autres frappent les sens par leur finesse, à l’image des poèmes iraniens. Pour sa part, la littérature francophone canadienne a longtemps été intimement liée à l’histoire politique des communautés acadiennes, franco-ontariennes et francophones de l’Ouest. Au point que sa date de naissance correspond au choc provoqué par les États généraux du Canada français à la fin des années 1960. Comme énoncé lors de ce grand rendez-vous nord-américain, les Québécois amorcent alors un recentrage de leur identité à l’intérieur des limites territoriales de la province, laissant les Franco-Américains et le reste du Canada francophone à leur destin.
Dès lors, la littérature pratiquée dans les autres communautés francophones se détache de la grande sœur québécoise. Presque 50 ans plus tard, les œuvres de ces auteurs ne se définissent plus comme de simples créations hors Québec, observe Benoit Doyon-Gosselin1, professeur au Département des littératures.
Premier signe de ce détachement graduel: des maisons d’édition locales fleurissent aux 4 coins de la francophonie canadienne. Si des pionnières comme Gabrielle Roy ou Antonine Maillet devaient publier leurs œuvres chez des éditeurs québécois ou français, les auteurs plus récents ont d’autres recours. Les Éditions d’Acadie figurent parmi les premières à émerger: un véritable acte de foi pour cette maison fondée à Moncton en 1972 grâce aux contributions personnelles d’universitaires et d’écrivains bien décidés à faire émerger une voix francophone distincte. En 1972, Prise de parole suit en Ontario puis, en 1974, les Éditions du blé au Manitoba.
Les Éditions d’Acadie ont fermé leurs portes en 2000, alors que les 2 autres sont toujours bien en vie. Et ces outils de diffusion ne sont plus seuls: le Regroupement des éditeurs canadiens-français compte aujourd’hui une quinzaine de membres, dont Éditions David à Ottawa et Les grandes marées à Tracadie-Sheila.
Crier qui je suis
Dès le départ, la littérature franco-canadienne est très fortement associée au combat identitaire de communautés francophones souvent isolées. C’est sans doute pourquoi elle se développe en grande partie autour de la poésie et du théâtre. «Il s’agit d’une prise de parole liée à l’oralité, analyse Benoit Doyon-Gosselin. La publication de poèmes, par exemple, prolonge les déclamations pratiquées dans les assemblées ou dans les cuisines de la poésie alors organisées à Sudbury.»
 Et le professeur de citer le recueil Cri de terre, publié en 1972 par Raymond Guy LeBlanc. Une poésie très identitaire, considérée comme le premier jalon de la culture acadienne moderne. Par ses poèmes, notamment Je suis Acadien, l’auteur tente de répondre aux questions qui taraudent sa communauté, particulièrement sur ce qui la distingue des anglophones des Maritimes. «Je suis Acadien je me contente d’imiter le parvenu / Avec son Chrysler shiné et sa photo dans les journaux». Écrit au vitriol, ce recueil incarne aussi le refus de se taire et le droit à l’indignation collective.
Et le professeur de citer le recueil Cri de terre, publié en 1972 par Raymond Guy LeBlanc. Une poésie très identitaire, considérée comme le premier jalon de la culture acadienne moderne. Par ses poèmes, notamment Je suis Acadien, l’auteur tente de répondre aux questions qui taraudent sa communauté, particulièrement sur ce qui la distingue des anglophones des Maritimes. «Je suis Acadien je me contente d’imiter le parvenu / Avec son Chrysler shiné et sa photo dans les journaux». Écrit au vitriol, ce recueil incarne aussi le refus de se taire et le droit à l’indignation collective.
Une pièce de théâtre comme Moé, j’viens du Nord, s’tie, écrite par André Paiement et jouée au Théâtre du Nouvel-Ontario à Sudbury en 1971, interpelle aussi les familles francophones de cette région minière du Nord. «Une partie du décor de la pièce se composait des photos prises dans les villages lors des représentations précédentes, une façon d’ancrer encore plus l’œuvre dans le vécu de la communauté», raconte le chercheur.
 Le texte dramaturgique Le chien, de Jean-Marc Dalpé, un des premiers prix du Gouverneur général décernés à un Franco-Canadien en 1988, poursuit dans la même veine identitaire. À son retour des États-Unis pour faire la paix avec son père, Jay se rend bien compte que son village natal en Ontario reste coupé du monde, tout aussi étouffant et désespérant que lorsqu’il a pris la fuite 7 ans auparavant.
Le texte dramaturgique Le chien, de Jean-Marc Dalpé, un des premiers prix du Gouverneur général décernés à un Franco-Canadien en 1988, poursuit dans la même veine identitaire. À son retour des États-Unis pour faire la paix avec son père, Jay se rend bien compte que son village natal en Ontario reste coupé du monde, tout aussi étouffant et désespérant que lorsqu’il a pris la fuite 7 ans auparavant.
 Le lieu et la langue
Le lieu et la langue
En s’intéressant aux auteurs et aux œuvres de la littérature franco-canadienne, Benoit Doyon-Gosselin a pris conscience des liens qui unissent tous ces écrits, par-delà les frontières géographiques qui séparent les provinces. «Le rapport difficile à l’espace se pose dans plusieurs textes, comme dans celui de Pierre Albert, Le dernier des Franco-Ontariens, publié en 1992, note-t-il. Contrairement aux Québécois, les autres francophones ne disposent pas d’une entité géographique sur laquelle appuyer leur identité.» Le Nord ontarien mythique devient donc un personnage à part entière. Tout comme le Moncton utopique façon France Daigle: la romancière s’amuse par exemple à donner des noms français aux rues, dans une ville qui en compte si peu en réalité.
Les auteurs francophones utilisent souvent une langue qui mélange joyeusement français et anglais. De nombreux écrits illustrent le grand écart linguistique que vivent au quotidien ces communautés en contexte minoritaire. Joey Tremblay, un dramaturge de la Saskatchewan, choisit ainsi de faire parler ses personnages en anglais mais avec une syntaxe française. Une façon d’illustrer la disparition de son village francophone dans Elephant Wake.
Extrait vidéo:
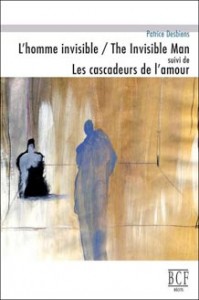 Autre approche, celle de Patrice Desbiens dans L’homme invisible/The Invisible Man, paru en 2008. Ce Franco-Ontarien présente son texte original sur les pages de gauche et une traduction de son cru à droite. Il traduit son propre texte en oubliant les détails, comme pour mieux montrer que le passage d’une langue à l’autre n’est jamais innocent. Ce texte a été adapté au théâtre.
Autre approche, celle de Patrice Desbiens dans L’homme invisible/The Invisible Man, paru en 2008. Ce Franco-Ontarien présente son texte original sur les pages de gauche et une traduction de son cru à droite. Il traduit son propre texte en oubliant les détails, comme pour mieux montrer que le passage d’une langue à l’autre n’est jamais innocent. Ce texte a été adapté au théâtre.
 Le rapport à l’autre, que cet autre soit anglophone ou métis, est d’ailleurs bien présent dans de nombreuses fictions franco-canadiennes. Le roman Le soleil du lac qui se couche, de l’auteur manitobain J.R. Léveillé (2001), met en scène la rencontre entre une métisse urbaine et un moine japonais. À partir de réflexions sur l’art et l’architecture, la jeune femme découvre ses origines et finit par s’accepter.
Le rapport à l’autre, que cet autre soit anglophone ou métis, est d’ailleurs bien présent dans de nombreuses fictions franco-canadiennes. Le roman Le soleil du lac qui se couche, de l’auteur manitobain J.R. Léveillé (2001), met en scène la rencontre entre une métisse urbaine et un moine japonais. À partir de réflexions sur l’art et l’architecture, la jeune femme découvre ses origines et finit par s’accepter.
C’est peut-être ce questionnement sur l’identité qui rapproche le plus les différentes littératures francophones, estime Benoit Doyon-Gosselin, même si en surface les œuvres reflètent la réalité de leur coin de pays. «Je rêve du jour où, dans les écoles des différentes communautés francophones, on donnera un cours commun sur les littératures ontarienne, acadienne, fransaskoise (Saskatchewan), manitobaine…», s’exclame-t-il.
Mieux reconnue, mieux connue
Plongé depuis plusieurs années dans cette littérature, Benoit Doyon-Gosselin constate que les œuvres et auteurs franco-canadiens bénéficient d’une plus grande notoriété et d’une meilleure reconnaissance depuis le milieu des années 1990. La preuve: les jurys de prix prestigieux, par exemple celui du Gouverneur général, récompensent désormais des auteurs ontariens, manitobains, acadiens.
 La poète néo-écossaise Georgette LeBlanc a d’ailleurs été la première non-Québécoise à remporter le prix Félix-Leclerc de poésie, en 2007. Son recueil Alma puise abondamment dans la langue et les histoires de la communauté de la Baie Sainte-Marie, pour raconter l’émancipation d’une femme durant la crise de 1929.
La poète néo-écossaise Georgette LeBlanc a d’ailleurs été la première non-Québécoise à remporter le prix Félix-Leclerc de poésie, en 2007. Son recueil Alma puise abondamment dans la langue et les histoires de la communauté de la Baie Sainte-Marie, pour raconter l’émancipation d’une femme durant la crise de 1929.
 Et depuis 2001, le Prix des lecteurs de Radio-Canada récompense des œuvres littéraires écrites par des auteurs issus de milieux francophones minoritaires. La gagnante de l’hiver dernier: Annie-Claude Thériault, avec Quelque chose comme une odeur de printemps.
Et depuis 2001, le Prix des lecteurs de Radio-Canada récompense des œuvres littéraires écrites par des auteurs issus de milieux francophones minoritaires. La gagnante de l’hiver dernier: Annie-Claude Thériault, avec Quelque chose comme une odeur de printemps.
Cette multiplication des honneurs littéraires s’accompagne aussi d’une meilleure couverture médiatique des publications franco-canadiennes. Des revues littéraires comme Nuit blanche ou Liberté consacrent régulièrement des dossiers thématiques à cette littérature ou critiquent les sorties les plus récentes. Même tendance à la reconnaissance dans le milieu universitaire, qui en fait désormais un objet de recherche. «Le regard condescendant que le Québec pouvait avoir sur cette littérature n’existe plus aujourd’hui», constate Benoit Doyon-Gosselin.
Cependant, la diffusion des œuvres reste encore limitée à un cercle d’amateurs éclairés. L’exception: l’auteure acadienne France Daigle, qui a acquis une grande notoriété depuis qu’elle publie chez Boréal.
 Son dernier roman, Pour sûr, prix du Gouverneur général en 2012, réfléchit sur le chiac et propose une fiction qui se nourrit de la langue du sud-est du Nouveau-Brunswick. Passionnée par les contraintes formelles comme l’écrivain français Georges Pérec, l’auteure a construit son œuvre monumentale selon la suite mathématique 12x12x12. Donc 144 chapitres de 12 fragments, chacun composé de 1728 passages de la vie quotidienne d’une famille. Un roman post-moderne, à mille lieues du récit historique à la sauce Sagouine d’Antonine Maillet, longtemps considéré comme le titre phare de la littérature acadienne.
Son dernier roman, Pour sûr, prix du Gouverneur général en 2012, réfléchit sur le chiac et propose une fiction qui se nourrit de la langue du sud-est du Nouveau-Brunswick. Passionnée par les contraintes formelles comme l’écrivain français Georges Pérec, l’auteure a construit son œuvre monumentale selon la suite mathématique 12x12x12. Donc 144 chapitres de 12 fragments, chacun composé de 1728 passages de la vie quotidienne d’une famille. Un roman post-moderne, à mille lieues du récit historique à la sauce Sagouine d’Antonine Maillet, longtemps considéré comme le titre phare de la littérature acadienne.
Pour sûr rapproche un peu Benoit Doyon-Gosselin de son idéal, lui qui rêve du jour où les œuvres littéraires franco-canadiennes d’Acadie, du Nord de l’Ontario ou des plaines de l’Ouest ne colleront plus autant à leur territoire et à leur peuple. À ses yeux, cela sera le signe que cette littérature, longtemps indissociable des thèmes identitaires, aura atteint sa maturité.
Publié le 11 juin 2013






Note : Les commentaires doivent être apportés dans le respect d'autrui et rester en lien avec le sujet traité. Les administrateurs du site de Contact agissent comme modérateurs et la publication des commentaires reste à leur discrétion.
commentez ce billet